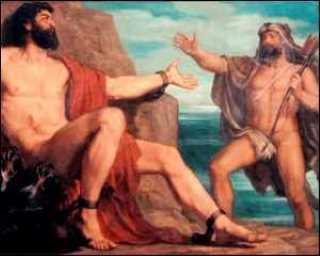Woolf
Par: Adam Mira
Dans le monde des religions monothéistes, l’homme se considère
supérieur, il est l’ombre de Dieu sur notre planète, malgré son péché et sa
désobéissance au Créateur. De même, que le monde s’identifie à la masculinité,
car, selon la bible, au commencement était le verbe et le verbe est
masculin.
Cependant, la femme, la « moitié » de l’homme, reste
depuis la nuit des temps opprimée et effacée siècle après siècle. Jusqu’au moment
où elle se révolte, elle cherche une place dans ce monde ou l’homme règne en
maître incontesté. Elle assure être capable de servir la société où elle vit et
réclame ses droits d’être l’égale de l’homme.
Malgré le temps écoulé et les acquis chèrement arrachés, la femme
peine à obtenir tous ses droits. Elle lutte pour obtenir la reconnaissance dans
le regard de l’autre, elle se bat avec acharnement pour que son destin
soit entre ses mains et non selon le bon vouloir de l’homme, le préféré de Dieu,
selon les écritures. Quel genre de justice vivons-nous ?
Dans cette voie, je parlerai de
l’histoire de deux dames qui essaient de donner aux femmes le goût de
s’affirmer, d’acquérir la liberté et de vivre en paix sans l’appui de
l’homme.
Deux époques, deux femmes, deux féministes, deux âmes rebelles,
chacune d’elles décide de son chemin, malgré les embuches et les obstacles qui
entravent leurs existences.
L’une est anglaise, Virginia Woolf, hantée par la guerre et la mort
et qui s’intéresse à la littérature depuis son plus jeune âge.
L’autre est québécoise, Paule Baillargeon, une féministe qui
s’attache au septième art et croit qu’à travers l’écran, elle pourrait passer
son message, celui d’une dame qui abhorre l’injustice.
L’une prend sa plume pour défendre sa cause, l’autre passe par la
caméra, cependant les deux ont le même objectif de défendre les femmes.
Virginia Woolf dans son essai «
Une pièce bien à soi » emploie son talent pour défendre les
femmes et insiste à travers plusieurs chapitres sur le fait que les femmes sont
capables de servir la société là où elles vivent. Pour parler d’elles,
Woolf voyage dans le temps en présentant des exemples pour intensifier la force
et la puissance de ses pensées. Chaque lieu, recoin ou place où elle se déplace
dans chaque chapitre de cet ouvrage est une occasion pour l’auteure de mettre
en avant ses idées concernant les femmes.

En revanche, Paule Baillargeon exploite
l’image dans son film « Trente tableaux » pour raconter
son histoire personnelle, faire son autobiographie depuis son enfance jusqu’à
son âge avancé et cela à travers des flash-backs, des bandes dessinées et
finalement d’un long métrage. L’histoire de cette femme est le récit de certaines
dames de son âge, ces dernières qui défendent leur droit tel l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la société. En partant de ce qui est écrit
ci-dessus, nous pouvons formuler notre problématique : l’écriture est-elle
une façon tangible et suffisante de défendre les femmes par Woolf ? Cependant, le septième art est-il assez
puissant pour exprimer la souffrance des femmes selon Baillargeon ?
C’est en se basant sur cette thèse que nous nous posons les
questions suivantes pour étayer notre pensée :
-
Quels sont les moyens pour que les
femmes puissent être capables de servir leurs sociétés et de devenir des
membres actifs et compétents ?
-
Quelle est la relation entre le lieu
et la réussite des femmes ?
-
Comment se présentent les deux
femmes dans leurs ouvrages, traumatisent-elles leur posture ou au contraire ?
-
Les visions de Woolf et Baillargeon sont-elles
distinguées étant donné que les deux femmes vivent dans des temps et lieux
différents ?
-
Woolf utilise l’écriture pour
défendre sa position vis à vis des femmes. Par contre, Baillargeon exploite le
cinéma pour la même raison. Laquelle des deux femmes arrive à bien défendre et
à transmettre sa pensée ?
Nous allons effectuer une comparaison entre ces deux femmes
créatives en se basant sur leurs ouvrages afin d’expliquer et de mettre en
avant leurs pensées vis à vis des femmes.
Il faut souligner que les références
sont nombreuses pour Woolf, par contre à propos de Paule Baillargeon mon
travail se base sur une étude académique réalisée en 2013 à l’université de
Montréal par Sophie Dubé, par ailleurs, j’ai consulté aussi certaines
interviews avec elle parues dans les médias québécois.
À Londres, le 25 janvier 1882 est née Adeline
Virginia Stephen, connue sous le nom de Virginia Woolf. Fille de Leslie
Stephen, écrivain, et de Julia Duckworth. C’est la deuxième fille d’une famille
riche et cultivée.
À l’âge de 13 ans, Virginia perd sa mère,
sa protectrice, et c’est le début de son chemin vers la dépression. Son père
bien qu’il soit cultivé, lettré et érudit, il n’envoie pas ses filles à
l’école, il pense que c’est du gaspillage d’argent de les envoyer étudier au
collège, mais elles reçoivent tout de même une éducation limitée à la maison.
La petite Virginia voit ses frère partir et retourner de l’école,
elle décide alors de lire et de dévorer la bibliothèque de leur demeure. Depuis
son bas âge, elle s’intéresse à la littérature. Sa relation particulière avec
sa sœur aînée Vanessa devient la clé de son succès dans la vie. Deux sœurs qui s’aiment
et qui protègent leur relation jalousement.
Le
père décide de se remarier et amène une nouvelle femme à la maison avec qui il a
de nouveaux enfants. Virginia vit parmi sept frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs.
Cependant, la mort ne s’arrête pas là, en
1897, sa demi-sœur Stella décède. Quelques années après, en 1904, son père décède
à son tour. Virginia vit péniblement sa deuxième dépression.
Après le décès du père, Virginia s’installe avec sa sœur Vanessa et
son frère Adrian dans une nouvelle maison, et là c’est le début d’une nouvelle
vie. Mais le destin la rattrape encore une fois, deux ans après la mort de son
père, son frère aîné Thoby s’éteint à l’âge de 26 ans.
Le décès de son père est, malgré le chagrin
et la détresse qu’elle a vécus, a été en quelque sorte le début de sa liberté. En
effet, Virginia et sa sœur aînée Vanessa (qui s’intéresse à la peinture) font
partie d’un groupe qui réunit certains artistes et intellectuels britanniques,
nommé Bloomsbury.
À l’âge de 22 ans, Virginia se marie
avec Leonard Woolf. Dépressive, un an après, elle passe à l’acte et fait sa
première tentative de suicide. Son mari l’amène vivre à la campagne. Virginia s’aperçois
que l’écriture est son refuge. Et, en 1915, elle publie son premier roman
"La Traversée des apparences". Deux ans après, les Woolf
fondent dans leur demeure à Hogarth House situé dans le faubourg londonien,
leur maison d’édition The Hogarth Press où Virginia publie tous ses
ouvrages.
En 1924, Virginia débute sa relation
intime avec Vita Sackville-West, une
poétesse britannique. Malgré cette relation qui est devenue notoire, son
mariage est sauvé in extrémis. En 1925, elle publie son roman Mrs
Dalloway qui a été bien reçu par les critiques et son succès est confirmé.
Quatre ans après, elle publie Une chambre à soi, et continue à écrire
jusqu’à son suicide le 28 mars 1941. Ce jour fatidique, Virginia s’est rempli les
poches de cailloux et s’est jetée dans le fleuve britannique Ouse.
De l’autre côté
de l’océan, dans le nouveau monde, loin de l’Europe et dans une époque différente,
une femme nommée Paule Baillargeon nait en
1946 en Abitibi-Témiscamingue au Québec. Issue d’une famille de classe moyenne,
elle emménage avec sa famille à Montréal alors qu’elle est enfant. Les années
passent rapidement et la jeune fille devient adulte. Elle décide d’étudier le
théâtre et s’inscrit en 1966 à l’École nationale de théâtre du Canada. Cependant,
c’est l’époque de la Révolution tranquille où le peuple québécois cherche à
affirmer son identité et à créer de nouveaux courants politiques. Paule, qui
possède une âme rebelle à cause de sa relation tendue avec sa mère, quitte
l’École de théâtre et commence son aventure comme artiste, actrice,
réalisatrice et cinéaste et finalement en tant que romancière. Elle vient d’ailleurs
de publier, en cette année 2016, son premier roman « Sous le lit. »
En 1901, la dame qui a marqué le siècle précédent, la reine
Victoria, s’éteint.
Bien que l’ère victorienne reste dominante en Angleterre jusqu’au
début de la Première Guerre mondiale, le pays
vit dans une situation précaire. Entre la crise économique, la montée
de la classe moyenne, la pression exercée sur les femmes…C’est dans cette atmosphère
bouillonnante que la littérature est en marche aussi vers une métamorphose. En effet, James Joyce, un Irlandais
catholique, Samuel Bulter, un Britannique protestant, sont deux écrivains talentueux
qui décident de se débarrasser des tabous qui étouffent la littérature
britannique. Par ailleurs, les femmes cherchent activement et avec acharnement
leur place dans la société. Et, c’est grâce à leur soutien à l’état pendant la
crise et la guerre qu’elles obtiennent en 1918 le droit de vote.
Woolf qui a publié son premier roman
un an après la guerre, continue dans cette voie littéraire avec sa sœur Vanessa.
Et, le salon de leur demeure devient un lieu de rencontre pour le groupe
Bloomsbury où les discussions restent animées jusqu’à l’aube. Cette époque est une
période enrichissante pour Woolf, l’occasion pour elle de s’instruire en
écoutant des hommes cultivés parlant de la psychologie, de l’art et de la
littérature.
Certains parfois étaient des sceptiques et d’autres même des athées… Alors
Woolf fonde avec son mari la maison d’édition The Hogarth Press et elle devient
au fur et à mesure une écrivaine incontournable au cours de la période
d’entre les deux guerres. En effet,
elle écrit des romans, des essais et des critiques, c’est une époque de
révolution à tous les niveaux et c’est aussi l’entrée de nouveaux
aspects à la littérature et à l’art aussi, sans négliger le cinéma, le
septième art.
Cependant, la Deuxième Guerre est déclenchée et son mari, juif de
confession, est recherché par les nazis. Malencontreusement, c’est en ces
temps de tourmente que Virginia décide de mettre fin à sa vie avant la fin de
la guerre.
Au Québec, une histoire différente bien
qu’elle soit dans la même voie. La belle province essaie depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale d’affirmer son identité, dont les femmes qui luttent avec
acharnement pour avoir leurs droits et leur place dans la société québécoise,
elles ont alors obtenu le droit de vote en 1940, après toutes les provinces
canadiennes.
Le changement radical début en 1960,
après la mort du premier ministre conservateur du Québec Maurice Duplessis décédé
en 1959. Ce dernier avait ralenti la réforme instaurée après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. L’arrivée des néo-libéraux et des néo-nationalistes sur la
scène politique a déclenché un progrès considérable dans le pays. C’est le
commencement des réformes : politiques, institutionnelles et sociales
réalisées entre 1960 et 1966. Avec ces
réformes, la révolution féministe commence au milieu des années soixante, c’est
l’année où Paule est entrée aux études. Femme
rebelle qui a une mauvaise relation avec sa mère, elle
entreprend sa vie de militante féministe, elle veut avoir sa place dans une
société qui a été dominée pendant longtemps par l’Église catholique et le Dieu
vengeur.

La
Révolution tranquille prend un virage violent avec l’émergence d’un mouvement
extrémiste : Le Front de libération du Québec qui veut un État indépendant
et sème la terreur lors de sa première opération militaire dans la nuit du 7 au
8 mars 1963 en visant trois casernes de l’Armée canadienne. Les
bombes continuent à frapper ici et là jusqu’à la Crise d’octobre de 1970 où
l’Armée canadienne intervient et arrête des dizaines des gens impliqués dans
cette affaire de violence et met fin au mouvement révolutionnaire. Après quoi,
les Québécois gagnent leur cause pacifiquement et accèdent au pouvoir.
Au début, il y a la parole, le mot,
et depuis le début de XXème siècle, on ajoute l’image en mouvement qui incarne
les personnages littéraires et essaie à travers des acteurs et actrices de
donner vie aux mots qui étaient coincés entre la première et la deuxième de
couvertures.
Depuis sa première apparition, le cinéma joue un rôle important
dans la société mondiale, il fait concurrence à la littérature et son influence
augmente au fur et à mesure au point de devenir le septième art.
Virginia possède
une plume incontournable et elle écrit des critiques de tout genre. Elle a d’ailleurs
saisi rapidement l’importance du cinéma, elle a écrit, en 1926, une critique
dans une revue américaine : « Il est clair que le cinéma a
recours à une infinité de symboles pour représenter des émotions impossibles à
exprimer autrement. ». Même
si la littérature raconte l’histoire de l’humanité à travers les épopées, les
mythes, les contes de fées et les fables…, nonobstant, le cinéma est venu pour
devenir une production universelle qui change le monde à travers un grand écran
et attire toutes les générations sans distinction.
En 1993, Paule
Baillargeon réalise son film intitulé « Le sexe des étoiles »
une adaptation du roman de Monique
Proulx, un long métrage qui a gagné plusieurs prix grâce au sujet controversé
de cette époque. Cependant, c’est le mariage entre la plume et l’image qui nous
intéresse.
C’est bien son âme rebelle qui guide Paula à
réaliser ce film et à transformer un texte littéraire en image et en mouvement.
En revanche, Woolf n’a pas
eu la chance de regarder un de ses chef-d’œuvres sur le grand écran, malgré son
instinct et son attrait vis à avis du septième art.
À partir de son ouvrage « Une
pièce bien à soi » paru en 1929 et traduit en français en 1956,
Virginia Woolf envisage de dévoiler sa pensée féministe à travers son
écriture.
Selon
l’introduction de cette œuvre, l’auteure a reçu une invitation le mois
d’octobre 1928 de la part de l’Université de Cambridge afin de donner une
conférence intitulée : « Les femmes et la fiction » où elle
met en avant les liens tissés par les femmes avec la littérature et qui sont
distincts de ceux des hommes.
Dans cette même voie, Woolf se lance
et rédige « A Room of One’s Own » qui est traduit en français
avec plusieurs titres : Une chambre à soi, Une pièce bien à soi et une
pièce à soi. Cependant, le contenu de cet ouvrage aux différents titres est le même, et pour ce travail j’utilise l’ouvrage intitulé :
« Une pièce bien à soi ». Celui-ci est subdivisé en six
chapitres. Dans chacun d’entre eux, Woolf excelle dans son style afin de
défendre les femmes et d’expliquer soigneusement les moyens à mettre en œuvre pour
qu’elles soient capables de participer activement à la littérature et à faire
partie prenante de l’histoire de l’humanité.
Depuis le titre, nous distinguions que
l’auteure veut passer un message clair et percutant que les femmes manquent d’espaces
et de moyens afin d’être capables de produire leurs œuvres et d’accomplir leurs
rêves. Selon elle, elles ont besoin d’un lieu intime dans lequel chaque créatrice
sera habile de faire ce qu’elle voudra sans empêchement et sans obstacle.
Dès le titre, nous comprenons qu’il y un sens dissimulé derrière
ces quelques mots, une invitation à la révolte pour que les femmes arrachent
leurs droits de la société qui les méprisent. C’est l’âme rebelle de l’auteure
qui se cache derrière cette plume de plomb qui veut émanciper l’être
féminin.
Cependant, à quoi
ça sert d’avoir un lieu intime sans avoir les moyens de survivre ? Cinq cent livres sont suffisants pour qu’une
femme puisse débuter sa vie. Dans plusieurs passages, l’auteure insiste sur cette somme d’argent. Selon elle, cela
est, tout autant, la clé de l’émancipation.
En voyageant à travers le temps, Woolf crée un personnage pour
soutenir son idée de l’habilité des femmes à inventer.
« Imaginons, puisqu’il est si difficile d’avoir accès aux
faits, ce qui se serait produit si Shakespeare avait eu une sœur
merveilleusement douée appelée, disons, Judith. La mère de Shakespeare ayant
hérité, il a dû aller au lycée et y apprendre le latin-Ovide, Virgile et
Horace- ainsi que des rudiments de grammaire et de logique. C’était nul ne
l’ignorance, un garçon indompté qui braconnait des lapins, avait peut-être tué une
biche d’un coup de fusil et dû, un peu trop tôt, épouser une femme du coin qui
lui donna un enfant également un peu trop tôt. Cette fredaine l’envoya tenter
sa chance à Londres. S’il avait semblait-il un goût pour le théâtre, il
commença par tenir les chevaux à l’entrée des artistes. Très vite, il obtint du
travail au théâtre, devint un acteur à succès et vécut au centre de l’univers,
rencontrant tout le monde, exerçant son art sur les planches et son esprit dans
la rue, et il se fraya mène un chemin jusqu’au palais de la reine. Pendant ce
temps, j’imagine que sa sœur extrêmement douée était restée au foyer familial.
Elle était aussi aventurière, aussi pleine d’imagination et avide de découvrir
le monde que lui. Mais elle ne fut pas envoyée à l’école. Elle n’eut pas
l’occasion d’apprendre la grammaire ou la logique, encore moins de lire Horace
et Virgile. De temps à autre elle prenait un livre, peut-être parmi ceux de son
frère, et en lisait quelques pages. Mais alors ses parents pénétraient dans la
pièce et lui demandaient de repriser les bas ou de surveiller le ragoût au lieu
de rêvasser sur des livres et des journaux. Leur ton aurait été sec mais
aimable, car c’étaient des gens riches qui connaissaient les conditions de vie
de la femme et aimaient leur fille- il y a même fort à parier qu’elle était la
prunelle des yeux de son père. »
Ce passage sans grande
imagination raconte l’histoire de Virginia Woolf, celle-ci utilise son histoire
afin d’unifier les courtes phrases avec un pinceau humide pour que le passage
sèche en un seul bloc. Ce passage présente aussi l’amertume de l’auteure et
la tristesse profonde qui incarnait son âme depuis toujours d’avoir été privée
de l’école et d’avoir été négligée par sa famille. Elle est prisonnière de son orgueil qui l’a amenée à
devenir une personne tragique qui complique les choses.
Elle
insiste aussi sur le point que Judith fait partie d’une famille riche, elle est
intelligente et possède les moyens pour réaliser son rêve et aussi curieuse que
son frère, mais ces parents ne voient que leur fils. Woolf est tellement habile
qu’elle utilise des phrases courtes, distinctes et complètes. La ponctuation simple
sans exceptions. Elle utilise le récit à la troisième personne et veut formuler
sa pensée dès le début de façon claire et directe. Il n’y a pas de points de
suspension, mais au contraire une série de phrases enchainées.
Il
y a des subordonnées, des phrases complètes qui contiennent le prédicat, les
déterminants et le complément. La ponctuation de ce passage constituée de
phrases courtes montre la volonté de l’auteure de parler directement et de
passer son message sans tergiverser.
Elle
utilise aussi des phrases actives au passé pour évoquer certains souvenirs,
comme ceux où elle raconte sa propre histoire à la place de Judith la sœur de
Shakespeare. Ce passage ne contient ni parataxe, ni ellipse et ni verbe de
locution, ce genre d’écriture est la forme, en général, utilisée dans cet
ouvrage.
L’histoire de Judith est le récit de toutes
les femmes qui souffrent de l’injustice malgré leurs ambitions et leur
intelligence. Cette fiction montre que les femmes pourront être créatrices si
elles ont les moyens nécessaires à leur épanouissement.
Dans
le reste de ce récit, la fin est tragique, car Judith fuit la maison pour
réaliser son rêve, mais elle échoue, car personne ne croit en son talent, et
« Quant à moi, …….., il est impensable qu’une femme à l’époque de
Shakespeare ait possédé un tel génie. Car ce génie n’éclot pas au sein d’une
population laborieuse, sans éducation et servile. » Une fois de plus, Woolf
insiste sur la mentalité fermée de cette époque qui lie l’intelligence avec le
sexe et la classe de la société où les paysans n’ont pas étudié ou ne sont allés
à l’école.
L’écriture de Woolf est un cri qui provient
du plus profond de son âme meurtrie. Virginie a essayé par sa plume d’aider les
femmes à s’émanciper et à les sortir de leur situation misérable et inhumaine.
Elle a alors crié, voire hurlé à travers ses écrits, mais sans vivre assez longtemps
pour voir à quel point les femmes ont depuis fait du chemin sur la route de la
liberté.
Au début du
XXIème siècle, les femmes vivent une situation relativement meilleure que celle
du siècle précédent, mais elles sont encore bien en deçà des ambitions
féminines et le chemin de l’émancipation est encore loin. Cependant, les enjeux
sont différents maintenant, la nouvelle génération de féministes essaie d’aller
de l’avant en suivant le chemin tracé par les générations précédentes.
En suivant cette
voie, je parlerai du dernier film de Paule Baillargeon intitulé « Trente
Tableaux ».
Entre 2009 et 2011,
Paule reçoit de l'Office nationale du film du Canada l’ONF une offre pour
réaliser un film sur sa vie. C’est pour elle une formidable occasion de
s’exprimer et de réaliser une œuvre pleine de souvenir, mais à travers laquelle,
elle a guéri de ses plaies, de ses angoisses et de ses moments douloureux avec
sa mère qui ne l’aimait pas : « C’est
vrai, concède Paule, ma mère ne m’aimait pas. C’était une femme très révoltée
dont la révolte a déteint sur moi, c’est sûr, mais je ne peux pas tout lui
mettre sur le dos. »
L’amour des parents est à la base de l’équilibre émotionnel d’un enfant.
Et, si cet amour inconditionnel est prodigué pendant l’enfance, l’enfant sera
outillé dans sa vie future. Mais, dans le cas contraire, Il aura besoin d’un
effort indescriptible pour réussir, et c’est cette force de Paule qui l’a
finalement aidée à se réconcilier avec sa mère. Depuis le titre du film, nous remarquons
qu’il porte un sens dissimulé. En effet, c’est l’histoire de la vie de la réalisatrice
qui est encadrée dans les trente tableaux. Nous voyageons avec elle d’une scène
à l’autre, avec ses bandes dessinées, des dessins de son enfance, des scènes
montées par des acteurs afin d’expliquer une période de sa vie. C’est un voyage
dans le temps, un récit qui ressemble à certaines femmes de son âge.
La première scène du film montre une nonne portant
ses vêtements religieux qui retire son voile, nous voyons ses cheveux courts et
noirs, puis elle ôte aussitôt la croix et la jette. Cette scène bien encadrée par
un visage proche de la caméra, nous apercevons des yeux noirs, grands, pleins
d’émotions, un visage sombre sans sourire. Derrière la sœur, nous voyions
contre le mur une grande croix et des tableaux, ce passage déclenche le moment
de la révolte féminine contre l’Église catholique qui a dominé le Québec
jusqu’au l’aube de la Révolution tranquille. C’est le premier pas d’une révolte
contre la religion, l’injustice et la domination.
Jusqu’en 1927-1928, le
cinéma reste muet, il y a eu des tentatives afin d’accorder ou d’ajouter du son
à l’image en mouvement, mais la réussite n’est arrivée qu’entre les deux
guerres. Cependant, c’est très rare de trouver une voix off d’une femme
dans un film ou dans un commentaire, mais Paule choisit de le faire, et elle a
bien réussi à l’intégrer à travers son récit qui raconte l’histoire d’une femme
qui a vécu plusieurs rôles dans sa vie : femme, mère, féministe, actrice
et réalisatrice. L’utilisation du « Je » dans le long métrage, c’est
pour montrer qu’elle est le porte-parole de toute femme de son âge.
Le premier mot prononcé par la
narratrice est : j’écris ! Ce mot est suffisant pour dire que
les femmes ont le droit d’apprendre. Bien que l’apprentissage ait besoin d’un
long processus afin d’en maîtriser certaines connaissances. Cependant, ce mot explique rapidement la
nouvelle situation des femmes du XXème siècle pendant lequel elles ont eu le
droit de fréquenter l’école, puis l’université sans prêter garde à leur statue
dans la société. C’est une victoire incontournable pour le mouvement féministe.
Nous voyageons avec la
narratrice à travers sa voix dans le temps, de l’âge de 30 ans, à 60 ans et à
10 ans etc. chaque tableau représente un âge différent. Chaque scène, la
narratrice nous surprend par son talent créatif, une scène en couleur, l’autre en
noir et blanc, d’autres en bandes dessinées. Et, chacune raconte une histoire,
son histoire, l’histoire de sa génération.
« J’ai 59
ans, aujourd’hui je décide d’écrire tout ce que je sais sur ma mère, ma mère ne
m’aimait pas, ma mère n’aimait personne, ma mère était belle, ma mère était
jalouse, ……, ma mère m’admirait, ma mère aurait voulu être moi. » ce passage très
intime de la vie de la réalisatrice montre à quel point elle a souffert à cause
de sa mère, mais dans une interview Paule dit : « Ma mère et moi, on s’est beaucoup chicanées. Elle ne
comprenait pas qui j’étais. Mais à la fin de sa vie, on s’est réconciliées et
ça m’a permis de faire la paix avec elle et avec moi-même. » La scène
de Paule avec sa mère est avant la dernière dans son long métrage, elle se réconcilie
avec sa mère et avec elle-même, et elle finit son film en l’Abitibi, la ville
où elle est née, pour nous dire qu’elle retourne à la source.
Le film
« Trente Tableaux » est composé de plusieurs techniques d’art :
une lecture, une projection et une exposition encadrent dans chaque tableau une
période de la vie de la réalisatrice, son histoire qui nous amène à vivre à
travers son parcours la période de sa génération. Le scénario est bien
construit à travers des flash-backs et ce genre de construction a pour avantage
d’obliger le spectateur à le suivre jusqu’à la fin. Seule Paule connait la
prochaine scène, le spectateur suit les yeux rivés sur l’écran, il n’a aucune
idée de quelle époque elle va parler. La voix off nous guide, nous explique
avec une voix tendre et un accent particulier du Québec, bien que l’histoire de
cette femme soit l’histoire de beaucoup d’autres dans le monde. « J’ai découvert que je ne suis pas
folle ou alors, il y a beaucoup de folles comme moi. Des femmes racontent leur
vie. Leur humiliation, leur invisibilité, leur souffrance inouïe à regarder la
vie qui passe sans elles. Les femmes font la révolution et je veux
l’attraper pendant qu’elle passe. Je sais qu’elle ne durera pas. C’est trop
gros pour durer. L’histoire est en marche, il faut la raconter. » (Trente
Tableaux)
Woolf est
partie dans l’au-delà en laissant derrière elle des œuvres littéraires
remarquables qui font l’éloge des femmes et les encouragent à lutter pour prendre
la place qui leur est due dans ce monde. Quant à Baillargeon, elle réalise
des films et écrit des romans pour raconter l’histoire de femmes à travers le
cinéma. Chacune de ces deux femmes remarquables a choisi sa voie pour aider les
femmes à s’exprimer et à s’émanciper et à lutter contre l’injustice.
Je finirais avec une phrase
de Paule Baillargeon : « Le cinéma, c’est l’art de l’impossible. Pourquoi j’ai
voulu m’aventurer dans cet art difficile, qui coûte très cher, où on ne m’a pas
souvent fait confiance, je ne le sais pas. Sans doute parce que j’avais
beaucoup d’ambition et aussi parce que j’ai toujours été une fille d’images.»
Réaliser
un rêve est tout ce que nous avons pour continuer à vivre. A.M